Notre-Dame a subi le 15 avril 2019 un incendie d’une ampleur colossale. Le mobilier liturgique fut largement détruit par l’effondrement d’une partie de la toiture et les trombes d’eau nécessaires à éteindre le feu ont imbibé le superbe tapis de choeur, néanmoins miraculeusement stocké dans des coffres. Les 22 tableaux ont par contre pu être décrochés à temps pour limiter les dégâts. L’ensemble reprendra place dans la cathédrale le 8 décembre prochain.
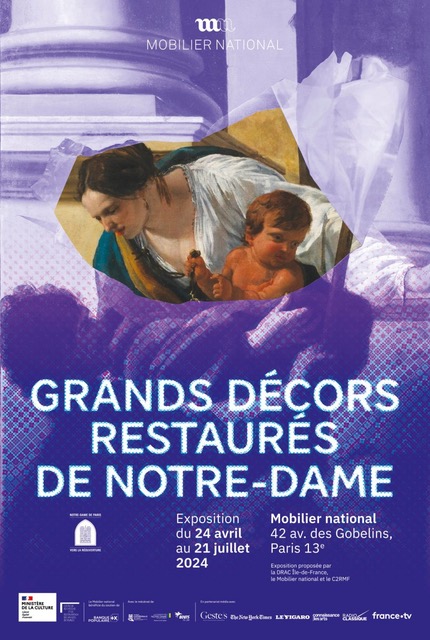

D’ici là, et jusqu’au 21 juillet, le Mobilier national expose l’ensemble, après restauration, en mettant en relief le travail des équipes. C’est aussi l’occasion de révéler les maquettes du futur mobilier liturgique imaginé par le designer et sculpteur Guillaume Bardet pour cinq éléments (baptistère, autel, cathèdre, ambon et tabernacle) qui sont en cours de finalisation en fonderie et deux des 1500 nouvelles chaises destinée aux fidèles, dessinées par Ionna Vautrin, en cours de fabrication dans les Landes.
La conversion de Saint-Paul, huile sur toile de 3,23 m x 2,35, réalisée par Laurent de la Hyre en 1637 :

Entre 1630 et 1707, ce sont 76 grands tableaux religieux, dus aux meilleurs peintres français, qui couvrirent peu à peu les murs de l’édifice, à l’initiative de la confrérie des orfèvres, engagée à en offrir un nouveau chaque 1er Mai, d’où leur nom de May. Il en subsistait 13 le soir de l’incendie. On les découvrira dans la grande galerie des Gobelins, accrochés à hauteur d’homme, ce qui est inédit. Ainsi le visiteur peut par exemple admirer la virtuosité du peintre à représenter les plumes des casques.
La conversion de Saint-Paul, détail :

Outre le tableau définitif, la scénographie intègre, pour chaque May, l’esquisse présentée au chapitre de la cathédrale qui pouvait demander des modifications, et, sur IPad, une vision « avant-après restauration » soulignant l’ampleur du travail. Le retrait des anciens vernis jaunis par les siècles a révélé la luminosité et les couleurs, et on peut noter la nécessité des retouches qui, désormais sont les plus légères possible, contrairement à des pratiques antérieures de restauration.
L’adoration des bergers, huile sur toile de 2,20 m x 2,95, réalisée par Jérôme I Franken (1540-1610) en 1595:

Un dossier scientifique a également été constitué pour chacune des toiles entrées au XIX° siècle dans la cathédrale après la Révolution, alors que l’édifice était délabré et sans décoration. La réflexologie infra-rouge a révélé de nombreux repentirs du peintre.
L’adoration des bergers, peinte dans le goût vénitien, est un rare témoin de la peinture religieuse parisienne de la fin du XVI°. De style maniériste, cette peinture narrative et réaliste montre un profond humanisme. Restauré en 1982 suite à un incendie ayant affecté sa partie basse, il a fallu ôter les retouches, souvent débordantes, ce qui a permis de retrouver des détails comme la tête de chien visible derrière le genou du berger.
exemple de travail de restauration :

Il est légitime de mettre en valeur le travail de restauration, financée par les crédits de la souscription nationale. Il a mobilisé 50 restaurateurs, 78 si on inclut l’équipe de transporteurs dont l’importance fut cruciale car le moindre déplacement de tableau requiert dix personnes, pendant 24 mois dans un atelier conçu spécialement.
tapis de chœur :


Le tapis de chœur, commandé par Charles X et offert par Louis-Philippe à la cathédrale, n’aura souffert que du poids de l’eau … et de l’appétit des mites qui se régalaient tranquillement à l’abri des regards. Après dépoussiérage, on répara les cassures et les déchirures consécutives aux manipulations du tapis lors de ses présentations dans la nef, et les dégâts causés par les mites. On ajouta un galon pour protéger la lisière originale du tapis qui conserve une fraîcheur tout à fait exceptionnelle.
Là encore on peut suivre l’évolution entre le projet original, prévoyant des fleur de lys, et le résultat final correspondant au contexte de l’après-révolution de Juillet 1830. C’est une occasion exceptionnelle d’admirer cette oeuvre (bien que montrée dans sa moitié) dont les dimensions hors normes, avec une superficie de plus de 200 mètres carré, et une longueur de 30 mètres, restreint son déploiement à des évènements marquants, comme le mariage de Napoléon III en 1853, la visite du tsar Nicolas II en 1896, la venue du pape Jean-Paul II en 1980, et plus récemment pour la dernière fois en 2013 pour le 850° anniversaire de Notre-Dame.
Outre les maquettes de mobilier liturgique, le visiteur a la chance de pouvoir admirer aussi un ensemble de quatorze pièces monumentales tissées de 1638 à 1657, regroupées sous le nom de Tenture de la Vierge et qui devaient orner à l’origine le chœur de Notre-Dame, pour répondre au vœu du roi Louis XIII et de la reine Anne d’Autriche qui vouent une immense dévotion à la Sainte Vierge et qui se rendent très régulièrement à la cathédrale.
Les tapisseries représentent les scènes de la vie de la Vierge selon les Évangiles canoniques et apocryphes. La bordure unificatrice de l’ensemble, décorée d’angelots et de guirlandes de fruits, porte le chiffre de Richelieu et les armes des commanditaires. Le cartouche central donne la légende de la scène, et la date qui figure en bas, 1739, a été retissée pour marquer la nouvelle propriété de la tenture et le changement de propriétaire.
En effet, elles ont été vendues, et acquises par le chapitre de la Cathédrale de Strasbourg où l’ensemble se trouve toujours conservé dans son intégralité. Les alsaciens l’admirent une fois l’an, en décembre, lors des fêtes de Noël. Bien qu’en excellent état de conservation, la Tenture de la Vierge a été nettoyée et ne réintégrera pas Notre-Dame le 8 décembre prochain, puisque sa présence à Paris est un « simple » prêt. Pour des raisons de conservation, la tenture est présentée par roulement de sept tapisseries (24 avril- 9 juin ; 11 juin-21 juillet). Il conviendra donc de revenir une seconde fois.
Marie-Claire Poirier
(texte et photos)
Du 24 avril au 21 juillet 2024
Mobilier National, Galerie des Gobelins, 42 avenue des Gobelins, 75013 Paris
Du mardi au dimanche de 11h à 18h, dernière entrée 17h15 – Fermé le 1er mai 2024. – Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans, pour les 18-25 ans ressortissants de l’Union européenne, les demandeurs d’emploi.
