François-Henri Désérable poursuit son voyage en littérature. Après le registre de la biographie romancée ou du récit historique fictif, l’auteur français s’attaque aux voyages. Dans la lignée de Nicolas Bouvier et de « son envie de tout planter là », Désérable part à l’aventure, sur les pas du « Che ». Un récit sentimentaliste.
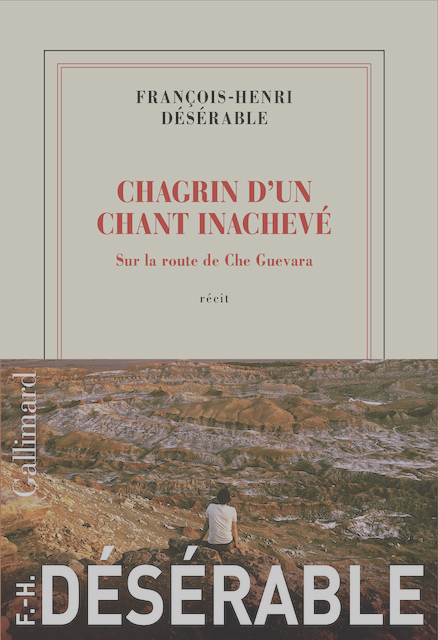
Il y a 65 ans. Un beau matin, Ernesto « Che » Guevara et son compère de route Alberto Granado, décident de partir faire le tour de l’Amérique Latine avec pour seul moyen de locomotion une motocyclette, leur fameuse Poderosa II. Depuis Córdoba, au cœur de l’Argentine désertique, les deux amis prennent la route. Le début d’un voyage initiatique. François-Henri Désérable résume ce qui pousse le « Che » à parcourir son continent par « l’aphorisme parfait » de Hippolyte Taine, « on voyage pour changer non de lieux, mais d’idées ».
Les voyages forment la jeunesse, complète le dicton, tandis qu’Alphonse de Lamartine rajoute qu’il n’y a d’homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé.
Quelles sont les motivations de François-Henri Désérable, explorateur contemporain de ces contrées lointaines ? « Voler vers l’ouest est l’accomplissement d’un rêve mythologique » confesse-t-il en préambule. Survoler le Pacifique c’est devenir « Cronos (…) c’est fendre l’espace et remonter le temps ». Au-delà de changer d’idées, il s’agit, pour le français, de comprendre cette partie du monde.
Plus qu’une aventure vers l’inconnu, c’est une sorte de voyage à travers le temps, dans ce passé si peu dépassé, que propose François-Henri Désérable. Accompagné de ses lectures de voyage des deux aventuriers argentins des années 50, Voyage à motocyclette et Poderosa, l’auteur se re-situe : « nous étions en janvier 1952. Dans le rétroviseur défilait la Pampa ».
Buenos Aires, Valparaiso, le Pérou, la Colombie : au gré de ses haltes, François-Henri Désérable remonte le chemin du « Che », comme pour atteindre la source, le point de départ. Pour parvenir à comprendre, à expliquer. « Il y a peut-être un moyen de comprendre ce que pour les damnés de la terre le Che représente » souligne l’auteur, alors à Lima.
Contrées éventrées
Au cœur de cette capitale grouillante, bruyante, au ciel éternellement gris, Désérable se rend dans un Pueblo joven (quartier jeune), « merveilleux euphémisme pour désigner ces lotissements sauvages ». Face à lui, le tableau d’un continent coupé en deux : d’un côté de la montagne, s’adosse de hautes propriétés bien gardées, cadenassées ; de l’autre, des bidonvilles « construits à la main, à la pelle, à la pioche », qui s’entassent. Et les chiens errants. « La colline aboie » : une personnification pour mieux dépeindre le tableau de conditions inhumaines, d’une ambiance dé-personnifiée, déshumanisée jusqu’au dernier souffle.
Ici, les habitants sont dépossédés, n’ont pas de « titre de propriété ». Ils n’ont pas de voix : ils ne crient pas, ne se plaignent pas. Ils ne font même pas attention aux étrangers, souligne l’auteur. La voix d’un peuple entier se tait. Le mur séparant les deux quartiers semble rendre vain toutes réclamations.
Adossé au mur (celui d’une autre honte), une petite fille. « Je la regarde et je songe au Che ». Le mur est toujours là, dur, froid, austère. Comme une tombe. Les espoirs d’une révolte pour redonner un écho à ces lieux semble enseveli.
« Et je n’emporterai dans ma tombe / Que le chagrin d’un chant inachevé ». Les vers du poète turc Nazim Hikmet, grand ami de Pablo Neruda, qui accompagne Désérable au fil de ses découvertes (notamment différentes maisons de l’auteur à travers le continent, dont une à Santiago), résonnent tristement.
Tout ce chemin parcouru pour rien ? De ces destinées de « survie dont on a fait une vie », au milieu de ces déchèteries qui servent de lieu de vie, François-Henri Désérable tente de réenchanter la volonté du « Che ». « Vous apprendrez qu’il tremblait d’indignation à chaque injustice, qu’il ne cessa jamais de proclamer sa foi en la révolution (…) de l’Amérique à l’Afrique ». On songe alors à Charles Plisnier, dans Faux Passeports (Prix Goncourt 1937) : « je disais que je venais au communisme par les voies de la doctrine, mais je sais maintenant que ce qui me persuadait, c’était les tristes images de la vie ».
Ces mêmes « images de vie » qui conduisent aux mirages des idéologies. Faire la révolution ? Dans la fureur, répond le « Che ». Celle qui lui fait gagner le Vénézuela, qui le pousse dans sa quête internationaliste, jusqu’au Congo, avant de déchanter, d’être emporté. Assassiné.
Chant inachevé, homme providentiel brisé, mais aussi, et surtout, des milliers de vies, d’hier à aujourd’hui, inassouvies : François-Henri Désérable ne peut qu’observer la douce image sentimentale de cette lutte passée, s’étioler, se cabosser dans un présent éternellement, inlassablement, dur. Malédiction ? Les latino-américains croient en Dieu, « mais est-ce que Lui croit en nous ? » questionne un chauffeur de taxi vénézuélien de Caracas à l’attention de l’auteur.
Quoi qu’il en soit, à Cuba, on croit toujours au « Che », dont le célèbre portrait de Korda (pris le 5 mars 1960) est placardé Plaza de la Revolución. Le tribun y siège fièrement, fait son siège, éternel. 65 ans après, si la photo n’a pas pris une ride, si le voyage reste toujours une possibilité pour les Hommes afin de comprendre et d’entendre le monde dans lequel ils vivent, la photo ne chante pas, ne chante plus.
Inachevé n’est cependant pas synonyme de lettre morte. Hasta siempre Comandante Che Guevara, entonnent certains, depuis un peu moins de 65 ans.
Gabriel Moser
Chagrin d’un chant inachevé – Sur la route de Che Guevara de François-Henri Désérable.
Paru le 8 mai 2025 aux éditions Gallimard – 196 pages – 20 euros.
