De Paris à Cordoba, en passant par Buenos Aires, le Mexique, l’Argentine, l’Afrique mais aussi Arcueil : Antonio Seguí est intouchable. Pour tenter de pénétrer la pensée de l’artiste franco-argentin, mais aussi de décrypter l’oeuvre de celui qui clamait, haut et fort, son caractère « indépendant », viscéralement opposé à toute assignation dans une case, Christine Frérot, dans La comédie urbaine aux éditions des ateliersHenry Dougier, fait parler ce qu’il reste des peintres, en chair et en os, lorsqu’ils disparaissent : leurs tableaux.
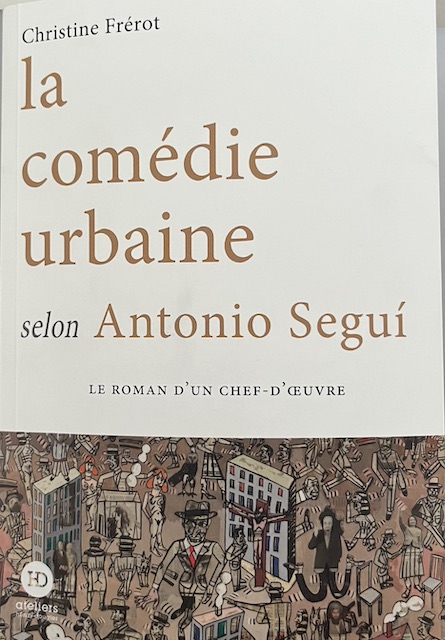
« Moi, señor Gustavo ». Le livre s’ouvre sur un dialogue intérieur de cet « homme au chapeau ». Le fameux Gustavo : « une sorte de héros, à la fois tendre et caricatural » ; attachant car il ressemble à tout le monde, intriguant en ce qu’il reste anonyme ; en un seul mot : énigmatique. Si ce señor anonyme fait l’objet d’autant de réflexions, c’est qu’il est central dans l’œuvre de Seguí. Le peintre argentin va en effet le représenter dans nombre de ses productions.
Pour comprendre l’œuvre de ce dernier et cette myriade de personnages qu’il propose de voir dans ces différentes toiles, Christine Frérot s’attache à retracer son parcours.
Rupture enracinée
La construction du bagage artistique de Seguí se fait avant tout en opposition à d’autres formes d’art, de mouvements artistiques. L’artiste argentin a en effet une vision singulière de la peinture. Dans les divers propos que rapporte Christine Frérot, l’on lit notamment que dans sa vision « c’est plutôt la forme qui peut porter le message politique et non le contenu de la peinture ». Cette réflexion est à l’origine de son œuvre.
« C’est ce séjour au Mexique », à la fin des années 50, livre l’auteure, qui semble sceller le destin artistique de Seguí. Face à une Ecole mexicaine « en quête de mexicanité » l’argentin refuse cette « peinture aux accents folkloriques ».
L’expressionnisme mexicain, avide d’une « identité esthétique » propre au Mexique et à l’ensemble de la culture latino-américaine, renferme un « discours ethnicisant » fait « d’idéologie et de nationalisme » qui ne touchent pas Seguí.
Ce cheminement de création n’intéresse pas l’originaire de Cordoba qui, « entre abstraction et figuration », soit entre forme et contenu, voue dès lors toutes ces louanges pour l’art figuratif. Le Mexique n’a donc été qu’une « parenthèse » , explique-t-il ; « Je ne suis pas un peintre politique, mais un homme politique » , rapporte Frérot.
Le positionnement séguiste est particulièrement intéressant. En reniant l’art mexicain de son époque, qu’il ne dénigre pas pour autant, reconnaissant rétrospectivement que « c’était pas mal foutu », ce dernier ne cherche pas tant, à l’instar d’un « peintre politique », ses racines dans l’art. A l’inverse, c’est parce que « je me considère enraciné dans ma culture » argentine, livre Seguí, dans laquelle se nichent des « choses inséparables de mon travail (…) [que], poursuit-il, je n’ai jamais eu l’intention d’apparaître comme un peintre argentin ».
Cette « rupture stylistique » analysée par Frérot et Seguí lui-même à l’époque, apparaît alors comme double. Elle procède, tout d’abord, d’une envie d’ « accorder la primauté au dessin » pour mieux, par la suite, développer son œuvre puissamment figurative, révélatrice d’une « marque identitaire » assumée, comme ce dernier le soulignera dans certains de ses propos.
En réalité, en tentant de se détacher de ses racines, Seguí les a dévoilées au monde entier aux travers de ces « textures urbaines ». De même, en ne participant pas à l’édification d’un esthétisme propre à sa région natale, l’expérience mexicaine s’est révélée être « à la racine de [s]on changement », c’est-à-dire quelque part, d’une production elle-aussi enracinée, reflétant une certaine vision du monde ; celle source de son succès, capable de « titiller l’imaginaire du regardeur ».
Peintre sériel
« Mon destin serait argentin et français, je le savais déjà » fait dire Frérot à Seguí au sortir de cet épisode. Si la suite de l’aventure du latino-américain aux accents européens très prononcés, passe en effet par ces pays, c’est avant tout les villes qu’il traverse, en tant que « textures citadines », qui dessinent alors réellement son parcours artistico-politique.
Le succès ne tarde pas à arriver. « J’ai même été considéré comme la révélation de la IIIe Biennale de Paris » s’enorgueillit Seguí. Au terme de l’exposition parisienne de 1963, il est en effet annoncé comme un « peintre neuf dans l’horizon ».
Le choix figuratif de Seguí s’avère payant. L’ensemble du microcosme parisien loue la série Felisitas Naón exposée par l’artiste à l’occasion de la Biennale. En bon arbitre partial, André Malraux déclare lui-même que « vous les jeunes argentins, vous avez gagné la partie ».
Ce premier succès lance ainsi le « destin parisien et international » du franco-argentin, décrypte Frérot. L’exposition permet de faire apparaître une notion clef dans l’œuvre de l’artiste.
Felisitas Naón n’est pas une production commune, c’est une « série ». Pour Seguí, le procédé sériel « est la continuation de l’idée qu’[il se fait] de la peinture ». Aucune de ses œuvres n’est donc véritablement indépendante ; il faut voir dans l’héritage de l’argentin avant tout une recherche, sinon une « obsession principale, et jamais délaissée » pour la « composition », note l’auteure.
Pour quels objectifs ? Seguí aurait-il peur que l’on ne comprenne pas ses productions si d’aventure elles n’étaient pas reliées entre elles ? A rebours de ce que l’on pourrait penser pourtant, les séries du sud-américain ne doivent pas se voir comme des tracés que l’on devrait suivre minutieusement pour comprendre ; la série ne balise pas l’œuvre mais l’ouvre à l’inverse.
« Chaque image serait le point de départ » explique Frérot, ce qui conduit donc à décrire ces séries non comme des œuvres guidées, mais plutôt comme une « sorte d’inventaire ». Seguí n’impose ni de début ni de fin à ces dernières car « en aucun cas il n’y a d’histoire » ainsi, avance-t-il. Dès lors, ces suites s’appréhendent comme des « suggestions » : « A vous de faire l’histoire » invite (ou ordonne ?) Christine Frérot.
Réveil d’une ville
C’est justement dans l’une de ces séries que surgit, resurgit ; disparaît, réapparaît, ce bon vieux Don Gustavo. « Suis-je un héros ? Suis-je le prétexte d’une histoire sans fin ? » ; est-il Gustavo où se nomme-t-il plutôt « Andrés, Alfredo, Ramiro » …
Derrière les questions du personnage que l’on retrouve dans l’un des tableaux les plus fameux de Seguí, Réveil d’une ville (2002), toute la beauté et la complexité – elles vont souvent de pairs – de l’œuvre de l’artiste apparaissent. Don Gustavo concentre toute la part d’incompréhension et de mystère, de clarté et de pertinence, qui émaillent les productions du franco-argentin.
C’est un personnage reconnaissable entre mille et pourtant semblable tout autant à dix mille, vingt mille personnes. « Je suis devenu un stéréotype frappé d’anonymat » écrit Frérot pour le décrire au cours de ce monologue intérieur fictif.
L’auteure se prête ici au savoureux jeu d’une synecdoque particularisante : elle décrit la ville séguiste, ces « textures urbaines », au travers d’un tout, celui d’un personnage énigmatique dans ce qu’il a de typique. Dans Réveil d’une ville, Don Gustavo est la « métaphore vivante de l’anonymat des villes, de l’uniformité », celle qui se retrouve dans le caractère « démultiplié » du citadin.
Frérot y voit une Comédie urbaine car humaine qui résume, de la manière la plus exacte, l’œuvre de l’argentin. Paradoxalement pourtant, cette « œuvre ouverte » souhaitée, procède d’une volonté d’emprisonnement du monde « dans le papier afin de le raconter », explique l’artiste.
Doit-on voir dans cette histoire de papier, un monde en carton ? Une critique de la « déshumanisation des mégalopoles », des « péripéties (…) frivoles » du monde urbanisé, en comparaison de la vraie, de l’authentique vie rurale ?
De Paris à Cordoba, en passant par Buenos Aires, le Mexique, l’Argentine mais aussi Arcueil, assiste-t-on à une perte d’identité généralisée, diluée dans ce flot incessant de visages déformés, aussi mouvants qu’interchangeables ? Ces êtres difformes, pourtant passablement uniformes ; ces créatures, se déplaçant d’un point A à un point B mais parcourant surtout l’espace à la recherche de l’inconnu dans une insatiable course tournoyante, sont-ils le reflet d’une urbanité en proie à la recherche de vacuité ; et la créant, par là même ?
A ce sujet, sans donner de réponses claires, Seguí nous fait une confession. Selon lui, « ce qui bouge et change, c’est cela qui demeure ».
En représentant l’instant, Seguí dépeindrait in fine ce qu’il y a de plus demeurant et ce, dans une œuvre d’une « amplitude créatrice totale » où se mêle tout à la fois ses « passions, (…) émotions, (…) peines et joies » liste l’auteure.
Ainsi, quoi de plus évocateur que la rue ? théâtre des passions humaines ; là où se tiennent révoltes et grands moments de liesse, l’un chassant l’autre. Tous deux radicalement opposés, mais faisant pourtant parties, irrémédiablement, d’une même série.
« Je dessine comme je respire » ; Seguí ferait d’ailleurs lui aussi partie de cette grande Comédie urbaine, comme vous et moi ; comme nous tous. De Paris à Cordoba, en passant par … « A vous de faire l’histoire ».
Gabriel Moser
La comédie urbaine selon Antonio Seguí de Christine Frérot
éditions des Ateliers Henry Rougier – collection Le roman d’un chef d’œuvre – paru le 6 juin 2024 – 113 pages – 13,90 euros.
